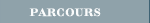Le rêve dans l'écriture romanesque
novembre 2008
Université Seinan-Gakuin, Fukuoka, Japon
Communication au colloque franco-japonais « Traduire le rêve »
31 octobre – 1er novembre 2008
Université Seinan-Gakuin, Fukuoka, Japon
Le rêve dans l’écriture romanesque : liberté et risques
Dans mes quatre romans, il ne se trouve qu’un seul rêve, et je me souviens très bien du débat intérieur qui a été le mien pour savoir si j’allais m’autoriser à l’écrire.
J’avais peur du rêve.
Peur que quelque chose m’échappe. C’est lentement que je construis un roman, lentement que je trouve les détails d’une situation, d’un personnage. Et des détails je garde ceux qui fonctionnent en échos les uns avec les autres pour former un univers. Je soupèse et mesure ce qui me semble à l’oreille, au tâtonnement de l’intuition, juste. Le rêve, et son tout-possible, son désordre apparent, amèneraient des niveaux de sens, souterrains, incontrôlables.
Et j’avais peur de l’ennui, cet ennui que j’éprouve souvent quand je rencontre un rêve, il est presque toujours annoncé, la tension de ma lecture se relâche. Je lis beaucoup de Journaux d’écrivains, de Carnets, et il est vrai que le récit d’un rêve est toujours si singulier qu’il m’apparaît comme une part non-partageable. J’ai l’impression de lire ce que je ne peux éprouver, mon attention tombe.
Quand on écrit, sa propre expérience de lecteur est toujours présente. La tension du texte, cette tension et le lien qu’elle instaure avec le lecteur, je l’ai toujours cherchée. Ecrire un rêve dans un roman m’a paru un danger, la perte possible de la tension, de l’équilibre de la construction - et encore je ne suis pas sûre que ce mot d’équilibre convienne, un roman est plutôt une mosaïque où tant de choses disparates déjà s’agglomèrent. L’introduction d’un rêve, c’est peut-être juste la touche de trop !
C’est ouvrir la porte à un autre monde qui ne reçoit aucun écho de ce qui s’est écrit jusque-là. Le propre du rêve, c’est tout de même son étrangeté, la perte de repères, le culbutage des lois, des critères, je pourrais dire l’avènement du désordre. Or un roman crée un ordre, quel qu’il soit, et c’est cet ordre qui peut instaurer le pacte de lecture, c’est lui qui, affermi, clairement installé, engage le lecteur à suivre l’auteur là où il l’emmène et où que ce soit.
Introduire un rêve, c’est admettre qu’un autre monde a tout autant le droit d’être là, même de prendre la place de celui qu’on a créé jusque-là, et penser que le lecteur y entre. J’allais y perdre mon lecteur, égarer le pacte de lecture, j’allais faire voler en éclats ce murmure que je distillais à son oreille, puisqu’un roman me semble un secret transmis de l’intime de l’auteur à l’intime du lecteur, et que le ton choisi, c’est-à-dire le point de vue sur la matière du secret à transmettre, lui donne sa force, sa cohésion, sa nature. Introduire le récit d’un rêve, c’est risquer de quitter le ton et le point de vue qui assurent le fil de la narration, le tendent, et tiennent le lecteur. Voilà ce qu’étaient mes doutes.
C’est dans La Lettre oubliée, à l’intérieur de la troisième partie, « Les Captives », que j’ai introduit un rêve.
Ce roman fait un portrait, le portrait d’une femme nommée Electre. C’est un roman sur la recherche de l’origine, sur les origines brouillées, redistribuées, élucidées. Electre fait un voyage en Italie du Nord pour voir le village dont sa mère était originaire, elle n’a jamais appris que son père n'était pas celui avec lequel elle avait vécu, qu'elle était née d'un compositeur de musique, et seul le lecteur connaîtra le contenu de la lettre qui lui était destinée.
Lorsque j’écris le rêve, j’ai déjà utilisé plusieurs modes narratifs. Il y a le récit qu’Electre fait aujourd'hui de sa vie à une jeune amie dans la première partie, le récit de journées de l’été 1905 depuis le point de vue du compositeur, et des lettres qu’il écrit à sa maîtresse dans la deuxième partie. Dans la troisième, Electre est mise en scène chez elle, et chez son amie Güna, à Paris et à Cannes. C’est le lendemain de leur arrivée à Cannes, qu’Electre raconte son rêve.
Ce rêve, je l’avais fait moi-même, la veille, ce qui était doublement étrange de souhaiter que, ce matériau-là si personnel, je l’inscrive directement dans la fiction que j’écrivais.
Je pense, bien sûr, qu’on est très travaillé par le livre qu’on écrit, pas seulement qu’on y travaille. Et ce livre sur les origines d’un personnage a beaucoup fouillé tout le temps de l’écriture dans mon propre imaginaire, mes souvenirs, mes peurs et mes désirs pour les traduire dans des élaborations fictives.
Je transposai bien sûr mon rêve en y ajoutant des éléments qui faisaient le raccord avec la trame romanesque. En l’écrivant, j’avais l’impression que j’ouvrais une trappe sous mon personnage.
Ce roman racontait des événements qui avaient échappé à la connaissance du personnage principal, jusqu’à qui était son père, et je livrais son trajet, son destin par des récits fragmentés. Donner encore un autre plan qui ne touchait plus à la construction mais qui ajoutait une connaissance par l’inconscient m’a paru quelque chose de riche. Comme si tout à coup moi-même je touchais la glaise humide, y enfonçais mes mains pour en sortir de l’informe encore. Je ne jouais plus avec des figurines en plâtre séché, que je disposais à mon gré sur le plateau de la fiction narrative, mais j’allais essayer de faire voir un autre côté de mon personnage, même informe, comme encore en gestation.
Et quand je parle d’un autre côté du personnage comme s’il s’agissait d’une construction cubiste, un portrait cubiste qui ferait voir toutes les faces en même temps, c’est inexact, ce n’est pas une autre facette. C’est la disposition psychique du personnage, traduite par de drôles d’images, scènes ou paysages.
« J’ai fait un rêve (…) J’étais à la fois la petite fille et la personne que je suis aujourd’hui. Dans le jardin de mes grands-parents, au bord du lac. Je me tenais sur le perron et arrivaient les bûcherons. Sans mot dire ils coupaient tous les grands arbres, jetaient les troncs dans le lac, et creusaient de profondes tranchées dans la terre grasse. (…) Des gerbes d’eau se soulevaient quand ils jetaient les troncs dans le lac, et les fosses creusées dans le jardin étaient comme des tranchées défensives en cas de guerre, ou attendaient des cercueils. En même temps, toute cette terre brune, humide, grasse composait un tableau si fort que je sentais le désir de chercher la force intérieure de la terre. Cette terre était attirante au point que je voyais dans ces tranchées des baignoires où me plonger pour tirer de l’énergie. (…) C’était la destruction de tout, et en même temps ce creusement de la terre au-delà des racines était la recherche de l’origine, la force première devait surgir de là. (…) Rien d’autre ne se passait. Il n’y avait personne d’autre là que les bûcherons, silencieux, et moi. Et le ciel gris où s’amoncelaient de volumineux nuages, qui gonflaient, se poussaient, prêts à tomber en pluie, mais la pluie restait suspendue, seule l’humidité avait tout envahi, la terre ouverte, la grande flaque que faisait le lac, les troncs, les tabliers de cuir luisants que portaient les bûcherons comme des bouchers ou des accoucheurs. Le jardin était un immense étal, ils débitaient en silence la nature qui avait été là et qui ne serait plus, parce qu’il fallait autre chose. Au-delà de la mort. Au-delà du carnage. »
Chacune des deux femmes va donner rapidement un sens à ce rêve, et laisser de côté les images fortes et ce qu’elles évoquent de destruction et de mort, « tranchées », « fosses », « cratères », « bouchers », ou ce qu’elles évoquent de fécondité, « le lac », « les gerbes d’eau », « la terre humide, grasse », « des baignoires », « la recherche de l’origine », « la puissance de la terre », « des accoucheurs ».
« Tu as peut-être peur de l’été ? », commente Güna, « Je crois plutôt que c’est l’envie d’un grand bouleversement (...) Table rase du passé », répond Electre. « Tous ces grands mots. Je n’y crois pas au chambardement ! A ton chambardement. Laisse toi vivre, plutôt. Doucement. Il te faut de la douceur, rien que de la douceur, ma Douce. Güna caresse la main d’Electre. Autour d’elles l’atmosphère est méditerranéenne. Elles sont arrivées hier soir dans l’appartement de Güna, (…) ». Je cite pour montrer comment la suite referme la parenthèse du rêve comme on referme une trappe, sans qu’en soit modifiée, en apparence, la trame romanesque dans laquelle il a fait irruption. Ce qui suit le rêve le referme, comme on referme un tiroir.
Mais le récit d’un rêve, c’est un tiroir à double-fond. Un personnage prend la parole, raconte le début d’un rêve, on est encore dans la trame du roman, et tout à coup la scène décrite crée un autre monde, le temps n’a plus la même durée, en quelques secondes un jardin devient le terrain dévasté d’une guerre, et plus irréel encore, un paysage allégorique. Avec des baignoires où tremper le corps pour se ressourcer, des gestes à la force surhumaine, des bûcherons qui jettent des troncs d’arbres dans le lac, et des figures qui ont double sens, les bûcherons avec leurs tabliers luisants sont bouchers et accoucheurs.
Puis le lecteur revient à Cannes, dans ce qui se noue entre les deux femmes. Mais ces images, l’eau, la terre, les tranchées, les cercueils, les baignoires, les fosses, ces images de fécondité, d’origine matricielle, de destruction et de mort resteraient, je le pensais, chez le lecteur. Pour avoir ce rôle, que je leur souhaitais, un rôle de contrepoint.
Un contrepoint à la mélancolie d’Electre au bord de la Méditerranée, qui semble n’avoir pas d’autre choix que de rester auprès de son amie, un contrepoint au caractère tragique de la mort de Güna. Un rôle de contrepoint mais aussi de reprise du thème sous-jacent, reprise de ce qui sous-tend l’histoire de La Lettre oubliée, la nécessité de se sentir relié à l’image d’un premier lieu, la recherche ou le souvenir de l’origine. Cette image de l’origine qui est toujours un désir de commencement, comme la préfiguration du terme, de la mort.
L’image d’un tiroir à double-fond qui m’est venue pour parler du rêve dans le roman, j’ai voulu voir dans d’autres romans, chez d’autres écrivains, ce qu’il en était. Ce qu’il en était du rapport entre le double-fond et le tiroir, entre le contenu du rêve et la trame narrative. La brusquerie avec laquelle on peut tomber sur ce double-fond, à quoi correspond-elle ?
Dans L’Education sentimentale, Flaubert écrit un seul rêve de Frédéric Moreau. Il prend place après le bal chez Rosanette, Frédéric y a accompagné Monsieur Arnoux. C’est sa première entrée dans la vie parisienne, tout l’étonne, il observe les comportements, les costumes, les gestes, les scènes à l’écart, les liens plus intimes, l’argent et le désir, il voit les signes sordides de la maladie, et se sent emporté jusqu’au vertige par la vision des femmes qui valsent tout près de lui.
Ce sont elles qui reviennent dans le premier moment de son assoupissement, une fois rentré chez lui : « … il voyait passer et repasser continuellement les épaules de la Poissarde, les reins de la Débardeuse, les mollets de la Polonaise, la chevelure de la Sauvagesse. Puis deux grands yeux noirs, qui n’étaient pas dans le bal, parurent; et légers comme des papillons, ardents comme des torches, ils allaient, venaient, vibraient, montaient dans la corniche, descendaient jusqu’à sa bouche. Frédéric s’acharnait à reconnaître ces yeux sans y parvenir. Mais déjà le rêve l’avait pris ; il lui semblait qu’il était attelé près d’Arnoux, au timon d’un fiacre, et que la Maréchale, à califourchon sur lui, l’éventrait avec ses éperons d’or. »
On assiste à un crescendo d’intensité et de liberté d’images, qui correspond à l’entrée progressive dans les profondeurs du rêve. D’abord l’image des femmes qui valsent devant lui pendant la soirée, puis l’apparition du souvenir de Madame Arnoux avec cette fraîcheur, l’image du papillon, puis l’annonce de Flaubert qu’on entre vraiment dans la profondeur du rêve, et dans un autre ordre d’image. Celle-ci est crue, dérangeante, on dirait une caricature de Félicien Rops : les deux hommes, Frédéric et Arnoux, attelés à la place des chevaux, et cette image que Frédéric a de lui-même, enfourché par la Maréchale à califourchon sur lui (image provocante de la femme qui chevauche l’homme) avec ce mot que choisit Flaubert, « éventrait », qui évoque une agression, une pénétration.
Ce qui frappe c’est la violence. Flaubert annonce le rêve, « Mais déjà le rêve l’avait pris… », le plus-que-parfait a une allure grandiloquente, provoque un effet d’annonce mais le contenu même du rêve est rejeté en quelques mots dans la deuxième partie de phrase. Il claque brutalement, d’autant plus brutalement que la phrase clôt un long chapitre de trente pages (!), le premier de la deuxième partie. Le rêve est rupture de ton par cette image violente et provocante, et après les longs développements de la scène du bal, rupture de rythme à cette place en fin de chapitre, je dirais « au bord de fin de chapitre ». Il marque un arrêt sur image. Il nous tient avec un effet de vertige juste au-dessus de l’inconscient de Frédéric, qui s’ouvre là béant, et dont on a une vision fulgurante : son angoisse de domination par une femme, son angoisse de pénétration.
Flaubert qui a fait vivre l’amour sublimé de Frédéric Moreau pour Madame Arnoux dans les cent cinquante premières pages du roman, soudain ouvre, avec ce rêve si bref, un double-fond dont la vision est saisissante. Et à cette place, l’effet sur le lecteur me paraît parfaitement programmé pour rester.
Il y a dans Anna Karénine de Tolstoï, au tout début du roman, un rêve étonnant parce que totalement discordant, saisissant de gaîté et de légèreté alors qu’on est plongé dans l’atmosphère dramatique d’une maisonnée sens dessus dessous. L’infidélité de Stépane Arcadiévitch Oblonski vient d’être découverte par sa femme, elle se refuse à vivre dorénavant sous le même toit que lui, et Tolstoï insiste sur la noirceur de la situation. « Le tragique de cette situation, qui se prolongeait depuis tantôt trois jours, apparaissait dans toute son horreur tant aux époux eux-mêmes qu’aux autres habitants du logis. (…) La femme ne quittait plus ses appartements, le mari ne rentrait pas de la journée, les enfants couraient abandonnés de chambre en chambre… ».
Or le rêve est décrit dans le paragraphe suivant : Stépane Arcadiévitch Oblonski - Stiva pour ses amis - se réveille brusquement et cherche à retrouver son rêve : « Voyons, voyons, comment était-ce ? Ah ! j’y suis ! Alabine donnait un dîner à Darmstadt, mais Darmstadt était en Amérique… Alabine donnait un dîner sur des tables de verre, et les tables chantaient « Il mio tesoro… » non, pas cet air là, un autre bien plus joli… Et il y avait sur les tables je ne sais quelles petites carafes qui étaient des femmes. »
Etonnant ! Et Tolstoï d’écrire encore à la suite : « Un éclat de joie brilla dans les yeux de Stépane Arcadiévitch. « Oui, se dit-il en souriant, c’était charmant, tout à fait charmant, mais une fois éveillé, ces choses-là, on ne sait plus les raconter, on n’en a même plus la notion bien exacte. ».
Le rêve, et cette clôture par Tolstoï, donne l’image qu’il coule sous le récit un fleuve souterrain, autonome. Dans ce roman tourmenté, noir, sur l’amour-passion, s’ouvre dès le début une trappe qui donne à voir un courant bien différent : le fond joyeux, licencieux même, l’aptitude au bonheur d’un des personnages. Et le rêve joue alors un rôle essentiel pour signaler la richesse de texture du roman.
Juste après les deux premiers paragraphes qui racontent une atmosphère sombre, tendue, dramatique, le lecteur est pris par des images abracadabrantes, translucides, chantantes et séduisantes. A l’opacité du drame, où plus rien ne se rejoint, chacun est irrémédiablement séparé, l’épouse d’un côté, le mari de l’autre, les enfants qui errent, à ce monde sans paroles, silencieux, étouffant, s’oppose ce rêve d’un repas joyeux, où les tables sont transparentes, chantent des airs légers et où les carafes - sans doute de vin, c’est-à-dire qui donnent l’ivresse -, sont des femmes, des femmes qui enchantent donc, au propre et au figuré, et non pas la femme réprobatrice, furieuse, en rupture. Cinq lignes suffisent, le rêve a montré l’épaisseur humaine, la contradiction que l’être humain peut donner au réel, juste par la révélation de désirs refoulés. Et le procédé, celui du rêve qui débute et finit brutalement parce qu’il est inséré dans une narration au caractère si opposé, apporte une énergie à l’écriture, l’énergie du contraste, un choc d’opposition, en rapprochant silence oppressant et chanson légère, opacité et transparence, isolement et convivialité, atmosphère confinée et ubiquité vertigineuse, Darmstadt, l’Amérique…
Quand je parle de courant souterrain, c’est comme si le rêve donnait un aperçu soudain sur ce qui pourrait être un sous-récit qui n’a pas la forme d’un roman, un sous-récit informe ou fait de toutes les formes possibles, de toutes les métamorphoses possibles, un sous-récit qui coule comme un courant souterrain, et qui donne une énergie à l’écriture.
Ce courant souterrain me conduit à Virginia Woolf, au stream of consciousness et on est là, en fait, très loin du rêve. Il n’y a d’ailleurs dans toute l’œuvre de Woolf qu’un seul rêve. Et si on va y voir de plus près, on a la surprise de constater que ce rêve, dans Mrs. Dalloway, qui est annoncé comme tel, - et deux fois il est dit : « … dont il venait de rêver » -, devient par un tour de passe-passe un récit du souvenir très précis d’une soirée à Bourton l’été où Peter était si passionnément amoureux de Clarissa. Il n’y a pas de récit de rêve. Mais juste avant, comme partout ailleurs dans le roman, saupoudrées de-ci de-là, ces visions de Woolf, l’auteur - qui rend tout perméable à sa vision, qui pénètre le psychisme de tous les personnages avec les images les plus oniriques, en faisant chanter son inconscient. Le roman de Woolf, ce n’est pas de montrer que les personnages ont un inconscient, que chacun a un inconscient, et donner à lire des rêves, c’est écrire avec son inconscient, son inconscient d’auteur, et pénétrer le psychisme de tous ses personnages, écrire les visions qu’ils ont de la réalité en utilisant son inconscient à elle. Et suivre toutes les images qu’elle sait développer, qui montent de son inconscient, images si riches de sensations, au registre si large, de l’extase à l’effroi, de la terreur à l’épiphanie. Le stream of consciousness est en fait le courant de son inconscient.
Et j’aimerais conclure par là : dans le récit du rêve, qui parle ? Les images sont si fortes, celles de tranchées, de cercueils, de fosses, de baignoires redonnant vie, dans mon roman, ou celle de Frédéric Moreau enfourché par la Maréchale, ou celle de ces tables de verre qui chantent, des carafes qui sont des femmes, que ces images mettent un doute sur le narrateur du rêve. Qui est le sujet ? Peut-on dire encore qui il est, à quoi il ressemble ce sujet, ce personnage qui éprouve des choses si étranges, contradictoires ?
Qui parle ? Plutôt que trouver une réponse à cette question, on peut juste dire : ça parle, ça s’écrit. Et le procédé du rêve même s’il s’annonce, prévient de son arrivée, délimite son territoire, en fait il parle de l’expérience de l’écriture. Je crois que pour l’auteur, il y a une expérience troublante de l’écriture, là où ça s’écrit avec des images inédites, qui s’appellent par correspondances libres et inconscientes.
Il y a aussi, je crois, l’expérience d’un effacement du sujet qui écrit, au bénéfice de l’écriture, au bénéfice de la présence de l’écriture qui révèle des choses incroyables, prend toute la place, prend la place de la réalité, et la place de l’auteur j’ajouterais.
On n’est pas loin du trouble d’identité comme symptôme d’auteur, et Aurélia de Nerval en est la plus forte expression, avec ces rêves qui s’enchaînent comme une cascade et donnent le vertige. Il y a dans l’écriture du rêve cette façon de flirter avec une réalité qui ne serait que dans les mots et la langue. Et donc une ivresse de liberté, mais aussi la peur de perdre le sens. Ce qui explique à mon avis ces moyens par lesquels le rêve s’annonce toujours, et délimite son champ, même si c’est le champ de tous les possibles. Virginia Woolf a préféré donner toute l’ampleur au courant de son propre inconscient. Mais écrire un rêve, dans un roman, c’est laisser une porte ouverte à l’expérience de l’écriture.
Ghislaine Dunant