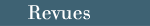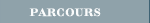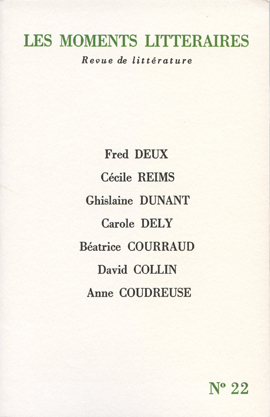Ce que j'ai appris de Fred Deux
juillet 2009
Les Moments Littéraires N° 22
Depuis plus de vingt ans, l’œuvre de Fred Deux joue un rôle dans ma vie.
Ça a commencé par un geste, un mouvement du bras qu’il avait, ou qu’il aurait eu.
En 1986, un ami m’a parlé d’un écrivain, il s’appelle Douassot, il est l’auteur d’un livre extraordinaire, La Gana. Il déposait chaque feuille écrite dans un carton au pied de sa table pour écarter loin de lui la page qu’il venait d’écrire.
Je n’ai jamais su si cette anecdote était véridique.
Mais cette histoire fut un sésame. Elle m’a paru lumineuse, elle m’a permis d’écrire L’Impudeur, mon premier roman, moi qui n’en finissais plus de corriger mes phrases. J’ai entendu qu’on pouvait imaginer un dispositif pour se placer dans un jet, préserver la foi dans le livre et la force de l’écrire.
J’ai pris chaque feuille écrite, et si je ne l’ai pas rangée dans un carton, je l’ai retournée et déposée au bout de ma longue table. La feuille devenait inaccessible, le texte se détachait de moi au fur et à mesure que je l’écrivais. Je ne pouvais m’occuper que de la phrase sous les yeux. L’écriture se faisait dans le présent, elle était possible là seulement. J’avais à me saisir de cette liberté, tout jouer là. Même si je retravaillerais tant de fois l’ensemble terminé, j’avais trouvé une entrée dans le présent de l’écriture.
Ça ressemblait aussi à un pari, et la contrainte d’un pari quand il dure.
Pendant des mois, j’ai retourné et déposé ce que j’avais écrit au bout de la table. Je m’y suis tenue. Quelqu’un l’avait fait, un écrivain et pas des moindres. Il me montrait qu’il fallait ruser, fermement ruser avec soi, qu’on pouvait s’inventer des stratagèmes, ce geste en était un.
Le nom de l’écrivain, le titre de son roman planèrent autour de moi, les années suivantes, comme un signe mystérieux, opaque, plein de pouvoirs. Je le gardai comme tel. Un talisman.
Un jour au détour de cimaises d’une foire d’art contemporain, je vois des œuvres qui me saisissent, elles ne ressemblent à aucune œuvre que je connaisse. Ces dessins, en fait c’étaient des gravures, gravées à partir des dessins par Cécile Reims, et éditées par Pierre Chave, m’ont fait l’effet de recevoir d’un coup quelque chose de mon monde souterrain. L’univers que j’avais sous les yeux était le mien, le mien profondément enfoui, qui soudain prenait forme, image, trait. Et trouvait une existence indépendante, là sous mon regard.
Je n’aurais jamais su lui donner sa forme, mais je rencontrais un artiste qui dessinait et montrait ce monde caché que je sentais vivre. Je pouvais le découvrir, et le déchiffrer dans une œuvre, sur un mur, derrière un verre. Une étrange expérience. Et c’était l’œuvre picturale de Fred Deux, c’était l’autre de Jean Douassot, mes yeux s’ouvraient.
Alors je l’ai lu, j’ai commencé par les écrits en marge des dessins, je m’habituais à lire et regarder ce qui venait de la même personne. Je veux dire, je découvrais deux arts qui marchaient de front. Fred Deux me réservait des surprises, il fallait que je m’accoutume à cette marche-là.
Puis je lus avec passion Terre Mère et Continuum qui est son Journal, parce qu’il décide à partir du milieu des années 90 de noter la date du jour quand il écrit, et ce parti pris sans doute l’incite à intégrer plus longuement les digressions. J’aime ces deux gros volumes à la couverture rouge magnifique, les beaux livres d’André Dimanche. J’aime ces livres, ce qu’ils disent du chemin vers le travail, à côté, avant, après.
Ce qu’ils disent des tâtonnements, et des remontées intérieures, de choses qu’on a en soi, du passé, qui viennent bouleverser les traits et les phrases. Ou comment ils évoquent les diversions qui écartent du travail, font croire qu’il est oublié, et puis justement qui viennent le nourrir, et j’aime cette disposition. Une ouverture élastique. Une grande liberté. Dans la crainte toujours que quelque chose de grave survienne aussi.
Fred Deux ouvre son écriture à ce qui se passe quand il est à sa table, à ce qui se passe dans sa main, dans son corps, son imaginaire, ce qu’il observe de la maison depuis dehors ou dedans, ce qu’il discerne chez sa compagne, ce qu’il remarque sur les chemins, ce que sa main ramasse, ce qu’il croit voir et ce que la nature lui révèle et comment son regard est trompé, ce qu’il vit quand il entre chez les voisins, ce qu’il observe de la chienne qui l’attend, des chats qui passent ou dorment.
Le Journal dit aussi au fil des paragraphes la force de l’écriture, qui l’attache, le lie. Il peut tant trouver par l’écriture et dire par l’écriture, le dessin semble tenu à distance, ne pas tenir face aux tremblements, aux finesses, à l’exactitude de la langue ou au contraire à l’incertitude qu’elle permet de rendre.
Et tout à coup c’est la remise en cause de ce qu’il semblait tenir, ce qu’il avait amadoué, en reprenant le crayon, en approchant la main de la feuille pour chercher le trait, qui va l’occuper comme s’il décidait de remettre en question sa place d’auteur, et d’affronter un autre monde, silencieux.
Et puis il y a eu ma découverte de La Gana, mon entrée dans ce roman fleuve, ce roman vie. La puissance de l’écriture bouscule tellement ce qui a pu être la réalité que je ne lis pas les souvenirs d’un passé ou la restitution d’une enfance, je lis une oeuvre qui dégoupille la vie qu’il avait à vivre. Il en écrit de cette vie, de ces scènes, combien elles étaient dangereuses à vivre et tout à la fois il écrit, fait comprendre que cette façon de vivre était la seule façon possible de vivre pour échapper à la mort.
Ce roman extraordinaire ne s’arrête pas, ne s’arrête jamais – le souffle ne fléchit pas, et sur 740 pages, Fred Deux a quelque chose à dire pour crever l’apparence de la vie qu’il avait. Il veut dire comment elle était, ce qui le menaçait et comment il a tout appris là. Plus il en écrit la mortelle menace, plus il fouille l’humanité de cette vie, l’humanité des hommes et femmes, essentiellement le père, la mère, la grand-mère, l’oncle, et ceux qui passent, qu’il côtoie, l’humanité des situations, tragiques souvent.
Chaque membre de sa famille est un point de vue sur la vie. Il découvre les comportements, les jugements émis, les silences, la mère, soumise, le père alcoolique, qui se laisse couler, l’oncle, qui voudrait être un roi, le roi de soi, « donc le roi du monde », la grand-mère, l’âme forte. « Je devinais pourquoi l’oncle l’aimait beaucoup (la grand-mère). Elle voulait aider à faire comprendre que tout n’était pas mal dans un geste, si laid soit-il. Laid parce que condamné (…) Elle croyait qu’il fallait aller jusqu’au bout de ses actes et les vivre (…) La grand-mère savait que les principes ne suffisent pas toujours et qu’il faut, si on veut tenir, aller plus loin (…) Rien ne l’aurait retenue en tout cas, ni les morales, ni les sanctions, ni la justice. Elle se moquait de tous ces épouvantails à idiots. Elle avait sa loi. Elle ne se posait pas en justicière devant sa fille mais en libératrice, et l’autre n’y pigeait rien (…) Ils devaient, lui (l’oncle) et la grand-mère, se rencontrer dans des zones où jamais ni le père ni la mère ne mettaient les pattes. »
Le feu, l’ardeur qui parcourent les pages de La Gana, c’est le feu, l’énergie qui possède le petit garçon déterminé à tout voir, à n’en jamais finir d’observer pour comprendre, pour discerner comment ils font, les adultes, pour vivre. Et l’écrivain, avec sa langue, cherche à épouser les incroyables faits et gestes, ceux des adultes que l’enfant observe, qui poussent toujours plus loin la capacité de supporter les colères, la peur, la violence du désir sexuel, le logement sordide, le mépris de certains, le manque d’argent. Mais pas le manque d’amour. L’enfant est aimé, il le sent. « Chez nous, on ne me battait pas ». « Elle (la mère) est bonne. Avec moi surtout. D’ailleurs avec tous. En y réfléchissant je trouve que nous sommes tous bons. L’oncle est aussi bon que le vieux. La grand-mère aussi. »
La cave où vivent les quatre, l’oncle dort au quatrième étage, cette pièce unique sordide, les murs suintent l’humidité, les égouts menacent, et l’irruption de ces eaux noires est une manifestation de l’Apocalypse, cette cave est pour l’enfant « un chaudron doux et humide ». Il y a quelque chose de la matrice dans cette cave, la matrice qui l’a porté. C’est un lieu protecteur malgré tout, dont il a si peur qu’on l’exile pour l’envoyer au préventorium. Et ce mélange du doux, de l’intime, du réconfortant avec l’horreur, la peur des égouts, la peur des colères terribles du père, la peur de la promiscuité, cet emmêlement complexe, Fred Deux en fait le cœur chaud et pulsé du roman, dont le sang frais et le sang vicié irriguent les images, les phrases.
C’était le lieu de formation, là où le monde s’organisait, où se distribuaient les places et les rôles de chacun, là où il pouvait chercher à percer le secret des gestes, des manies, le sens des mots prononcés pour comprendre qui faisait quoi, à qui, pour qui, et cela disait quoi de chacun ?
Comment il faut faire, pour vivre ? L’interrogation fondamentale, l’enfant l’a tout le temps dans la tête, et l’écrivain la fait courir le long des pages, elle ne s’arrête jamais. Et ce que j’aime, c’est qu’il n’y a pas de commencement marqué. « La vie déroule une interminable phrase », écrit Fred Deux dans Sous la mémoire. Le roman n’a pas un commencement signifié comme tel, le lecteur entre directement dans le flux, c’est une phrase de l’oncle à l’enfant, nous sommes à côté d’eux, nous sommes pris par le ton. Et le ton de La Gana possède toujours, paradoxalement, une pointe d’émerveillement. Tout dit la misère, et le mot se trouve deux fois dans la première page, et les observations consignées le disent à toutes les lignes, mais il y a de l’émerveillement car la misère, horrifiante parfois, est dépassée par quelque chose qui est la nécessité de chercher en dessous ce qui est vital, ce qui est la force de vie, ce qui tient en vie. Ce qui réchauffe le cœur : la solidarité, l’amitié, le réconfort, le plaisir, la débrouille, la traversée de la peur et sa libération, le lien entre les cinq membres de la famille, le lien à tous les personnages qui passent dans le roman.
« J’allais de découverte en découverte » comme il est écrit à la troisième page, et tout est découverte, sans que soit choisie la nature de la découverte, c’est ça l’émerveillement, extrêmement communicatif dans ce roman, la découverte de ce qui traverse les individus, ce qu’il y a d’incroyable dans chacun. La noirceur de la misère et ce ton d’émerveillement font un contraste au burin. Fred Deux écrit avec des phrases qui gravent les portraits, les scènes, les impressions.
« Tous ces hommes m’avaient un peu effrayé lorsque j’étais entré avec mes parents, alors que maintenant, là, mélangé à eux, je n’avais plus du tout peur. Je suis gai, joyeux. Je suis fier d’être avec des types qui ont chassé les rats, les chiens, qui ne mangent pas à leur faim, qui n’ont pas peur de coucher dans la rue, dans le bois. D’aller à l’hôpital. Des hommes sales, qui ne se lavent jamais, qui ne se déshabillent jamais non plus. (…) En pleine forêt avec des bêtes autrement plus féroces que les loups, les autres hommes. » Réussir à n’avoir plus peur de ce qui fait peur. Il y a dans le roman ce pari-là – qui est l’apprentissage de l’enfant, et qui est aussi le trajet que refait l’écrivain vingt ans plus tard : revisiter toutes ces peurs traversées. Chaque page contient une initiation parce que l’enfant comprend qu’il doit affronter et réussir à affronter ce qui se présente à lui pour continuer à vivre. C’est au fond la disposition de Fred Deux au-dessus de sa table à dessiner, ou ce qui le guide à écrire sur le carnet à côté de la feuille : affronter tout ce qui se présente, qui monte, survient, le vide comme le trop plein, le souvenir, la trace, l’inconnu, le trop connu.
Fred Deux a commencé ses premiers dessins, ses taches comme il les appelle, avec une sorte d’éblouissement devant les manifestations qu’il découvrait : la couleur et son éclat, la couleur écrasée entre deux feuilles, frottée au chiffon. Il laissait des traces s’imprimer et voyait des histoires se monter sous ses yeux. La feuille lui révélait un univers qu’il rejoignait dans l’éblouissement, comme on pourrait dire le ravissement ou la stupeur. Cette détonation intérieure je crois la percevoir encore quand je regarde beaucoup de ses dessins, ou quand je lis ses phrases.
« Au début je vis un désastre général qui ruinerait tout, détruisant et brûlant ce que je connaissais pour, miraculeusement, me laisser survivre seul. Par la suite je n’en ressortais plus intact mais amoché. Enfin, je touchai le bout : je serais le seul à exploser sans attirer le plus petit intérêt sur mes cendres. Je me consumerais sur un trottoir ou dans mon lit. Les autres contourneraient le petit tas. » J’ai trouvé ce que je ressens, quand j’ai lu ce passage dans Nœud coulant. Il revient de l’explosion. Celui qui dessine ce dessin. Celui qui écrit les phrases du livre. Il revient d’une explosion.
C’est ce qu’il a vécu juste avant, ou ce possible qu’il ressent - l’explosion va avoir lieu, elle est imminente - qu’il déjoue en passant à la phase d’après, sur la feuille. Avec le tracé du crayon. Ou en créant une phrase.
Crayon qui ouvre l’espace et la surface du papier à une autre mémoire. « Sous la mémoire », comme le signale le titre d’un de ses livres, ce qui était sous la mémoire, qui se met à vivre après l’explosion. Qui ne peut soudain que remonter.
« Un travail qui s’effectuera en se servant de moi », écrit-il.
Vouloir écrire c’est chercher quelque chose qui est caché derrière, se laisser porter par des indices. Qui peuvent avoir la forme de labyrinthes. Et s’y perdre pour les découvrir et les décrire. Juste ça. Les dé-couvrir, les écrire.
A la suite du passage que j’ai cité plus haut où le jeune garçon est attablé à côté de ces hommes qui lui ont fait si peur, « quand j’étais entré avec mes parents », et qu’il réfléchit à son autre grand-mère, il l’imagine, difficilement, embrasser un homme, voici ce qui est écrit : « J’ai trempé le bout de mon doigt dans une des perles de vin, sur le bois de la table. Je fais une petite route et rejoins une autre perle. Je regroupe toutes les perles du coin où je suis. Les ronds que les bouteilles laissent au cul, des trois verres de mon père, de l’oncle et la vieille, je les relie entre eux, places, rues, avenues. Une ville brillante, aux avenues de vin, de chaleur, à deux doigts des têtes de vieillards de la vie. » Le garçon dessine, laisse remonter le tracé d’une ville. Le paragraphe suivant, il se met à observer et comparer le crâne de tous ceux qui dorment affalés autour de lui, son père, l’oncle, le patron, le chauve, puis tous les autres. L’importance de relier, rapporter les traits les uns aux autres, les détails, les traces, les marques, les croûtes. Qu’est-ce qui peut relier, rejoindre et faire une autre organisation ? Un autre organisme ? D’autres compositions ?
Comme dans les grands dessins de Fred Deux. Réunir, emmêler, rejoindre, tracer un filet, créer des organes, créer de l’organique, autre, étrange, et étranger mais relié. Chercher l’organisation, une organisation qu’il y aurait derrière le chaos. Ou montrer, comme sur tant de dessins, qu’il y a un jumeau de soi, à côté, dans l’ombre, étranger mais un double de soi, miroir de l’étranger en soi. Ramener l’obscur, le caché, le souterrain et le faire se rejoindre pour imaginer une vie continue qui relie tout ce qui est étrange. « Rien n’est totalement séparé dans cette vie sur terre. »
Dans les emmêlements du trait, il y a des nœuds, des creux, des ovales, le crayon tourne et revient comme si le crayon n’aimait pas s’arrêter. Comme s’il n’avait jamais à se lever, jamais à fuir, jamais à être suspendu dans le temps au-dessus de la feuille, non, il doit rester en contact avec la feuille, comme si la feuille était la vie, la vie possible, à ne pas fuir surtout, ne jamais perdre le contact. Il y a une humilité du crayon, ou de celui qui tient le crayon : c’est la vie qui est forte, le crayon a à la suivre, il ne domine pas, il n’impose pas, il n’exécute pas. Il trace.
Comme la phrase. Elle épouse la vie, le mouvement, l’émotion, la réaction : souple, rapide, syncopée parfois, longue qui s’étire parfois aussi - et la langue qui jamais ne s’arrête parce que la vie n’arrête pas.
Dans la langue de Fred Deux, les mots ne sont pas faits pour désigner les choses, et pour reprendre ce que dit si bien Henri Meschonnic, « les mots sont là pour nous situer parmi les choses ».
Ses liens aux choses, aux personnes, aux scènes, aux ombres, ces liens à suivre, dans les livres ou dans les dessins, ces liens tracent une sortie, celle de la possibilité de l’anéantissement. Il me semble toujours que Fred Deux la traverse, l’a traversée, et il raconte juste après. Comme il a traversé enfant l’inondation de la cave où ils vivaient, où il habitait avec ses parents, inondation qu’il fait revivre non seulement dans La Gana mais dans plusieurs de ses textes, et qui me reste comme un sauvetage, - il a été sauvé et il aurait pu périr -, et comme une initiation aux puissances souterraines. Même si ce sont les égouts qui ont débordé, c’est bien autre chose que les égouts qui ont débordé, c’est la puissance symbolique, mythique de cette eau noire qui charrie le péril. Ils ont envahi le lieu de vie, la plaque de fonte, ce couvercle infernal fiché dans le sol, qui hante ses rêves, n’a plus pu les retenir. Surnage un rat énorme. Qui ressemble à un lapin - métamorphose stupéfiante.
Burlesque et tragique, les registres se mêlent mais, plus au fond, dans cette nécessité évidente de la langue du roman, des récits, des dessins, il y a un courant, une source dont parle Fred Deux lui-même : « Tout ce que j’ai dessiné, tout ce que j’ai écrit est venu vers moi, hors de mon vouloir, à mon insu, car j’ai toujours été honteux en accueillant des images. Cette honte a accompagné tout ce que j’ai fait. Voilà presque cinquante ans que je vis couché sur mes papiers. J’ai bu ma honte. Et si je veux aller plus loin et répondre à la seule question qui attend, en moi : pourquoi as-tu honte ?
Je peux répondre à la manière de ma mère qui me recommandait, pendant mon enfance, de ne jamais rien dire. Elle croyait que nous étions là pour taire aux autres ce que nous avions subi, ou ce que nous savions. De là cette impression de haute gêne d’avouer en dessinant, d’avouer en écrivant, en me retenant pour le ressortir. » (Le massacre des Innocents in Fred Deux, dessins et textes 1949-1995)
Cette honte, la honte qui habite l’écrivain, la honte d’être en face de l’intime de la vie à dire, n’est-ce pas de cette source-là que viennent les récits de Kafka et de Dostoïevski ? Honte qui pourrait être le couvercle. Etouffer. Etouffer l’expression, ralentir le travail. Honte qui est aussi le moteur, elle donne sa tension à l’écriture, elle doit percer ce qui freine et retient.
Ce que j’ai senti à la lecture de La Gana, c’est que Fred Deux savait aussi la combattre, ou plutôt lui répondre à la honte, avec de la jubilation. Comme une vigueur qui a trouvé sa raison. Dans le chaudron de l’écriture, la cave intime.
En 1991, quand Karl Flinker, le marchand de tableaux, est mort, c’était un ami, je ne connaissais pas encore les dessins de Fred Deux. Je les découvre en 1993. Et j’apprends bien plus tard le rôle de Karl à Marseille en 1950, quand il demande à Fred Deux la permission de regarder ce qui est rangé là dans un carton, au premier étage de la librairie où Fred Deux travaille. Et quand il découvre les premières « taches », je peux imaginer combien il a pu y être sensible. Sa culture, il était d’origine autrichienne, pouvait l’avoir préparé, il connaissait l’œuvre de Klee, de Wols. Il convaincra Fred Deux de monter à Paris, et exposera en 1951 plusieurs de ses oeuvres sur les murs de l’étonnante librairie allemande de son père, Martin Flinker.
Karl Flinker fut un des passeurs qui a acheminé mon premier roman jusqu’à la table de mon éditeur, Gallimard. Une autre anecdote, comme un autre fil dans la trame qui me lie à Fred Deux, à son œuvre, littéraire et picturale.
Ghislaine Dunant