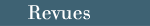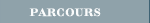Lectrice de Christa Wolf
septembre 2012
LITTERall Littératures de langue allemande N°19
LECTRICE DE CHRISTA WOLF
« Désormais je ne me sentirais plus liée par quoi que ce soit. »
Il ne faut jamais croire les écrivains. Il faut les lire. Parce qu’il y a toujours quelque chose derrière les mots, après que les mots sont dits, qui dort, caché, ou se tient prêt à exploser. Ecrire, c’est peut-être jouer à cacher et faire apparaître. Et lire, attendre et découvrir. Il y a des îles inconnues dans l’océan d’un livre.
La phrase que je cite en tête se trouve au tout début d’Incident, qui raconte une journée de la narratrice pendant l’opération de son frère au cerveau et peu après l’explosion de Tchernobyl. Deux centres névralgiques sont touchés. Deux centres atteints dans toute leur vulnérabilité. La narratrice, prise à parti par la situation, est à la fois sœur, écrivain, citoyenne, amie, voisine, mère, fille, et petite-fille. Ces voix s’expriment, s’interrogent, à l’intersection de deux mondes, le personnel et le collectif. Christa Wolf fait tout de suite dire à sa narratrice : « Désormais je ne me sentirais plus liée par quoi que ce soit ». Une autre sorte d’explosion, que de ne plus se sentir lié à quoi que ce soit. Une façon de répondre à l’explosion.
Il reste au texte à écrire ce qu’il en est.
Tout de suite observations et réflexions se bousculent, se mêlent et s’emmêlent, sans ordre. Les cerisiers en fleurs, les poules du voisin qui picorent le gazon fraichement semé, l’heure très matinale, l’entrée en salle d’opération, les ondes des pensées bienveillantes, la contamination mortifère, la douche, la nappe phréatique, l’enfance du frère et de la sœur.
Ne plus se sentir lié par quoi que ce soit, mais les choses se lient entre elles, et nous prennent dans leurs rets. Surtout, elles nous tissent, elles nous font. « On est franchement content quand on arrive à se faire une idée concrète de quelque chose. » Soulagement d’identifier, identité retrouvée. Sommes-nous autre chose que ces mille choses si différentes qui viennent s’imposer ou qui emmènent nos pensées et nos sens ?
Christa Wolf remplace l’éventualité d’une identité explosée – ou devrais-je dire de la matière explosée, ou du cerveau mis à nu – par l’écriture d’un continuum. « J’ai entendu quelqu’un penser en moi. » Elle y met de la surprise. De la bonne surprise. Une forme d’émerveillement.
Elle guette tout ce qui se passe, et qui se glisse jusque dans les interstices de la matière fissurée parce que c’est ça l’explosion de Tchernobyl, ce n’est pas seulement la contamination qui s’infiltre insidieusement partout, c’est la fission qui sépare les molécules, atteint le noyau, délie jusqu’au centre. C’est aussi ce qui libère l’énergie. L’énergie de poser toutes les questions. « Que devient la souffrance dont nous ne pouvons pas avoir conscience - », quand le corps est anesthésié. La langue veut être capable de rattraper ce que la technique peut effacer, ôte, et que nous, nous interrogeons, imaginant que des traces existent. Au moins que nos questions en soient les traces.
« La vie comme une suite de jours. » Phrase légère et brève. Une suite n’est pas ce qui nous lie. Mais une suite, ce peut être une suite de menus plaisirs, une suite de sensations qui mesurent nos jours, l’infime mesure de plaisirs inaltérables (si possible) qui peuvent faire croire à une identité, à quelque chose de ferme. Mesurer le café avec la cuiller jaune, savourer l’arôme qui se répand dans la cuisine, réussir à cuire l’œuf cinq minutes malgré le minuteur détraqué. Nous existons. « Nous vivons. » Minuscule phrase, dense, qui transporte la force du sentiment de vivre, et dont Christa Wolf se sert comme d’une charnière. Pour passer très vite à ce qui compte, et qui prend plus de temps à dire : « Je me suis arrêtée, tenant à la main la tasse que je voulais poser dans l’évier, et j’ai pensé plusieurs fois de suite… », pour exprimer ce qui est concomitant, ce qui ne va pas nécessairement ensemble mais qui a lieu, fait le lien imprévu, et tisse la nécessité des choses, donc la nécessité d’être.
Tout se passe comme si le nerf de son écriture était de traquer ce qui passe dans sa tête comme ce qui se passe dehors et de faire de ses observations précises, tenaces, têtues, le lien des choses entre elles.
Peut-être ces liens révèlent-ils la nécessité de vivre, et notre place.
Un silence dans une conversation avec sa fille au téléphone, et elle sent « un secret dissimulé avec le plus extrême raffinement. J’ai aussi vu défiler des images que je ne songe pas à décrire. Je n’ai pu néanmoins m’empêcher de me demander si je n’aurais pas dû depuis longtemps déjà décrire plus crûment et avec moins de ménagements vis-à-vis de moi-même les images qui surgissaient en moi, mais j’ai su en même temps que ceci n’était pas la question, et bien que j’aie senti que tout ce qui se passait en moi demeurait flou, insuffisant dans tous les sens du mot, j’ai pu encore une fois admirer comme tout s’enchaîne avec une sûreté de somnambule : l’envie d’une vie tranquille, … » J’interromps ma citation d’une phrase qui se poursuit, j’ai voulu juste en épingler l’ironie légère vis-à-vis d’elle-même. La phrase donne un exemple de la variété de ce qu’elle tisse ensemble, comme avec des cordons de couleurs, et, par leurs couleurs si dissemblables, elle signale l’ampleur de ce qui est à vivre. Est-ce toujours pour nous ? C’est la question qui peut se glisser à l’intérieur sans être posée.
Cacher dans les phrases d’autres questions. Y réussir avec des phrases qui semblent partir à la pêche de choses simples, naturelles, je veux dire à quoi il est naturel de penser, et en même temps glisser vers des questions auxquelles on ne pense pas ou on n’aime pas penser. En tout cas, employer un langage qui est celui qui cherche l’expression avec des mots précis et concrets, très loin d’un style à métaphores comme celui d’une amie écrivain qu’elle entend au téléphone commenter la journée de l’explosion : « La planète a perdu son émail, on dirait. » Christa Wolf intègre la phrase à son texte mais dans cette langue qui n’est pas la sienne et qui la fait penser à tous « ces compagnons de la corporation qui – la mort, la ruine, la faillite et les menaces de toutes sortes autour d’eux – poursuivent imperturbablement la ligne qu’ils se sont fixée un jour en écrivant, fous de mots, tendus vers un but dont la distance ne diminue jamais. » Voilà qui est dit. Tout ce qu’elle n’est pas. Ne peut pas être. Ces fous de mots, imperturbables. A l’abri des menaces qu’elle sent tellement présentes, elle, se défiant des mots, des mots qui viendraient trop vite, trop rassurants, qui ne laisseraient pas le temps de les regarder de face, de voir ce qu’ils feraient accroire trop vite.
Des questions se révèlent plus graves que d’autres, et Christa Wolf leur supprime le point d’interrogation. Comme s’il ne fallait pas que ce soit une question, parce que l’interrogation ne relève pas d’une incertitude. Elle masque autre chose, qu’il faut déjà pointer. Manifester qu’il y a quelque chose de non-résolu, et qu’on ne peut pas mettre en doute.
Je me souviens du passage dans « Trame d’enfance », quand la mère de Nelly, Charlotte, tend une portion de soupe à ce prisonnier tout juste sorti de camp de concentration. Elle lui demande s’il était communiste pour avoir été enfermé. Il répond par une question: « Mais où donc avez-vous tous vécu. » que Christa Wolf écrit sans point d’interrogation et que son paragraphe suivant commente. « Ce n’était pas une question. (…) Il se peut qu’au cours de ces journées (…) un manque flagrant de force, de confiance, de discernement ait mis provisoirement hors d’usage certaines possibilités de la grammaire allemande. Les propositions interrogatives, énonciatives et exclamatives n’étaient plus ou pas encore utilisables. Certains, dont Nelly, sombrèrent dans le mutisme. D’autres se mirent à parler tout seuls, à voix basse, en hochant la tête. Où avez-vous vécu. Qu’avez-vous fait. Que va-t-il se passer maintenant. Sur ce mode-là. » Ce ne sont plus des interrogations. Les questions soulignent la consternation, et la nécessité écrasante de prendre en compte une réalité lourde, grave. De s’interroger sur la responsabilité.
Et quand il s’agit d’une opération au cerveau, et qu’il faut se reconnaître après que le bistouri a coupé des parts dans « cette sphère où tout est fixé, ce que nous sommes, et si nous sommes ainsi ou autrement », des questions se posent-t-elles encore ? Ou faut-il juste faire entendre le défi dramatique, et abolir l’interrogation. « Quel nombre, quel genre de privations, de lésions pouvons-nous éventuellement tolérer sans devenir étrangers à nous-mêmes. » Voilà c’est dit. Après, peut-être, se donner la possibilité de choisir…
J’aime ce livre dont la lecture inlassablement m’inquiète, inlassablement me confie la nécessité de l’écriture, et me confie ce que l’écriture donne. Librement. Entièrement. A qui s’y donne, et à qui la lit.
Lorsque la narratrice se réjouit de trouver des trèfles à quatre feuilles dans le pré, elle ajoute : « Je ne les trouve que lorsqu’il n’y a personne qui pourrait les chercher pour moi. » Il y a dans cette phrase non seulement la vérité de l’activité d’écrivain, l’indispensable expérience solitaire, mais l’énergie aussi qui découle de l’activité d’écrire, et qui court dans son texte, le sentiment d’assister à l’expérience d’une singularité têtue et qui libère chez moi, lectrice, le goût d’associer, de chercher des associations en m’affranchissant de toute frontière entre les registres : plus l’écart semble grand, plus les semblances fonctionnent pour me donner durablement une autre façon de voir. Jusqu’à « la liberté de rompre avec toute obéissance ».
Comme si le pouvoir de la langue était de tout attraper, assouvissant le désir de tout pouvoir dire… « Justement ! » Et cet adverbe, servi en interjection, revient souvent dans les dialogues avec le frère, où leurs arguments s’affrontent, s’opposent, lui le scientifique ne voit pas comment on pourrait s’arrêter dans ses recherches à l’idée qu’elles peuvent avoir des applications destructrices, et elle s’interroge, comme de croire qu’on peut tout dire, n’est-ce pas ouvrir la langue à son pouvoir destructeur… Son frère lui rappelle qu’elle lui avait dit un jour « que les mots pouvaient faire mouche, et même détruire comme des projectiles », et elle poursuit « savais-je moi-même toujours peser si mes mots étaient blessants, voire destructifs ? Quelle est l’ampleur de la destruction qui pourrait me faire reculer ? Ne plus dire ce que je pourrais dire ? Plutôt m’enfoncer dans le silence ? » A cette place le paragraphe s’arrête, la ligne suspendue à un blanc.
La question soulevée a besoin de l’arrêt des mots.
Et on comprend aussi que le désir, la nécessité de tout dire avec les conséquences que cela peut entraîner porte aussi la conscience combien l’arrêt des mots, leur suspension, le silence, peuvent avoir d’efficacité dans l’expression, le rendu des choses, des sentiments, des réflexions. Comme des ondes, ses pensées traversent l’espace pour rejoindre son frère et son esprit et corps endormis, comme les phrases suspendues travaillent le lecteur, traversant le silence. Pour rejoindre des pensées ou des sentiments endormis jusque-là, et que la lecture vient éveiller.
S’interroger sur les limites à tout dire et le devoir (éventuel) de silence ? Lucidité cruciale, autocensure, la question semble ouvrir la boîte de Pandore de l’écrivain. Le ver est-il dans le fruit ? Croire au pouvoir de la langue, et voir le déchaînement d’un pouvoir qui deviendrait maléfique, simplement parce qu’on ouvre toutes ses possibilités ?
Tension des nerfs à imaginer les conséquences de l’explosion, de toutes les explosions auxquelles elle pense, attente des nouvelles de l’opération, et l’imagination de toutes ses conséquences possibles, la colère de la narratrice explose, les projectiles fusent dans un coin de la cuisine… Mais le mouvement du texte ne s’arrête pas pour autant, « Je me suis rendu compte que mes doigts s’étaient crispés… j’avais mal aux épaules et au dos et je me suis mise à faire des exercices d’assouplissement. Ce faisant une mélodie m’est passée par la tête… je n’arrivais pas à retrouver tout le texte parce qu’une question venait se glisser au premier plan: Où est ton frère Abel ?... Et qui ose la question en guise de réponse : Suis-je donc le gardien de mon frère ? »
Qui écrit la vitesse de la lumière de la pensée ? Et que dans cette succession illégitime, hasardeuse, irrévérencieuse, se trouve la nécessité d’écrire parce qu’elle contient notre réception du monde, sa conscience, incertaine, mais dont il est certain qu’on ne peut s’y dérober. C’est de ce thème que joue Christa Wolf, le prenant, le cachant, le reprenant.
« … Je suis restée plantée au milieu de la cuisine, et pour la première fois, j’ai compris que le second, celui qui répond par une question, ne se dérobe pas. » Sa crainte de se dérober, qu’elle pourrait fuir une question, fuir une image, une association, fuir, se dérober. J’aime qu’elle choisisse cette expression, « se dérober », et laisse entendre sa crainte, qui parle du désir d’être à la hauteur, digne du langage, croire au pacte avec les mots, à ce qui nous lie aux mots. Car eux peuvent nous « dire ». Eux peuvent nous permettre de souffler, parce que eux parlent !
Ce patchwork, sa langue l’organise, sa langue en fait une architecture. Et grâce à un mouvement de sa part de distanciation. Il n’y a pas d’empathie dans son écriture, d’émotion. Elle ne nous plonge pas dans un vécu comme si c’était le nôtre. Elle suit ses propres mouvements de pensées, d’images, de réflexion, comme un cours extrêmement personnel, avec des mots précis et prosaïques pour tenir à bout de bras chacun des effets ressentis, les décrire, les cerner, les authentifier.
Il s’agit de voir, pas de croire. D’analyser, pas de comprendre. Pas d’empathie, mais la création d’une architecture de soi. Et ne pas laisser de côté les zones d’ombre, ce qui fait échec à l’expression mais n’existe pas moins. C’est la tâche de l’écriture d’en cerner la manifestation, et elle a sa façon franche de la nommer : « la tache aveugle que mes mots, quelque mal qu’ils se donnent, ne veulent pas connaître ». Elle dit sa crainte de tomber sur cette tache aveugle en soi dans laquelle les mots n’arrivent pas à entrer. Elle se ménage des entrées par tous les bouts possibles de son expérience. Inlassablement elle exprime elle raconte, elle dit elle questionne elle va chercher. Ne pas se dérober. « Tu dois seulement dire comment c’est arrivé ! » reprend-elle avec joie, la joie d’avoir trouvé ce qui peut la sortir de là, citer le vers d’un poète du dix-neuvième, dont elle ne livre pas le nom, ce qui compte c’est la perche tendue, l’expression exacte du mouvement de son écriture. « Tu dois seulement dire comment c’est arrivé ! » Incident ! Et son sous-titre, Nouvelles d’un jour.
Au milieu de la journée, la narratrice qui voudrait se reposer, faire une halte, prendre un livre, dit cette phrase-clé : « J’ai trouvé que le livre que j’aurais voulu lire un jour comme celui-ci n’était probablement pas encore écrit. »
Mais il y a des livres qui donnent la mesure de ce qui peut être écrit.
Incident que j’ai lu à sa sortie en France en 1989, édité à l’époque seul, alors qu’aujourd’hui le texte dans sa réédition fait partie d’un recueil, et que j’ai lu avant de découvrir les autres grands livres de Christa Wolf, reste pour moi un livre extraordinaire, par sa force et sa brièveté, un modèle de ce que la lucidité peut rendre quand l’écriture s’immerge dans la trame incertaine de nos vies.